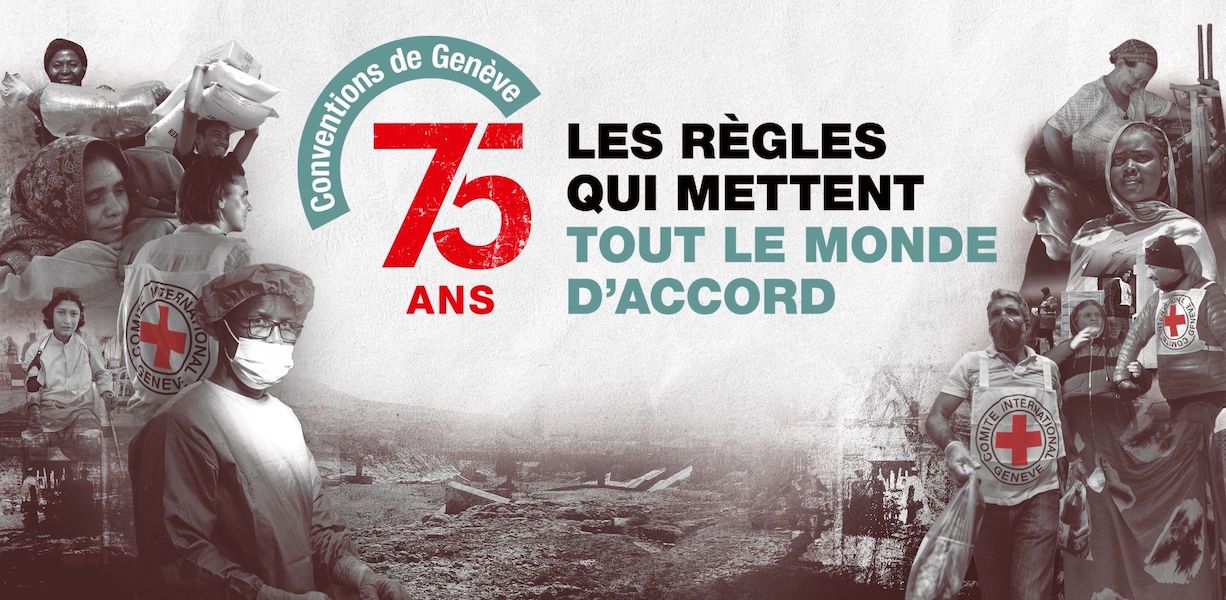Alors que ses voisins d’Afrique de l’Est ont adopté le paiement électronique, la République Démocratique du Congo reste fidèle à ses billets. Dans les marchés, les hôpitaux, les restaurants et même les supermarchés, le cash demeure le moyen de paiement le plus utilisé. Pourtant, le taux d’abonnement au téléphone mobile a fait une croissance remarquable allant à 62% de pénétration mobile sur l’étendue de la République Démocratique du Congo avec 50% d’utilisateurs mobile money qui consomment internet soit 32,3% de pénétration de l’internet sur toute l’étendue du pays, pendant que le taux de l’inclusion financière est à 38,5% en 2022. Pourquoi cette dépendance au liquide persiste-t-elle ? Entre frais élevés, régulation incomplète, faible interopérabilité, inclusion financière faible et méfiance culturelle, décryptons les causes du paradoxe congolais.
Un paradoxe économique
Dans une cabine rouge située en plein centre commerciale de Goma communément appelé Birere, environné par les femmes qui vendent des légumes, des poissons et différents épices ; des hommes qui tiennent des boutiques de vivres qu’ils vendent en gros et détails. Espoir Bisimwa, agent Airtel Money y reçoit plusieurs clients qui viennent pour certains déposer leur argent dans leurs comptes et d’autres faire le retrait qui leur permettent d’effectuer leurs achats.
La journée commence avec un soupir: « Chaque retrait peut coûter jusqu’à 3 % du montant, et les paiements marchands sont souvent supportés par le client, rendant l’usage dissuasif, Il n’y a pas de taux fixe unique : le montant des frais dépend de la taille de la transaction (montant envoyé ou retiré). Les petites transactions sont soumises à des pourcentages plus élevés, tandis que les grandes transactions bénéficient de taux plus bas proportionnellement et les commerçants, eux, hésitent à absorber ces frais. »
Même constat à Kinshasa, à Goma, à Beni ou encore à Lubumbashi: Malgré la présence de M-Pesa, d’Airtel Money, Orange Money ou Afrimoney, les moyens de paiement mobile présents dans le pays, les Congolais paient encore majoritairement en cash.
Dans le marché central de Kinshasa, Madame Kalala vendeuse de poissons, d’un ton moqueur nous dit : « le transfert mobile s’est imposé, mais le paiement électronique peine à se généraliser. Pourtant, pour un commerçant qui reçoit le payement via M-Pesa, il est probable que les frais soient intégré dans les frais de transfert ou de dépôt selon l’arrangement entre le commerçant et Vodacom. Comprenez que la crainte est autre que le coût de retrait. La monnaie électronique est plus traçable et j’ai peur de la surtaxation de la part du gouvernement. C’est pourquoi je préfère le payement cash qui est moins traçable ».
Cette réticence est profondément enracinée dans la peur d’une imposition accrue. Pour ces entrepreneurs, opérant souvent dans la vaste zone grise du secteur informel, l’avantage de la rapidité et de la sécurité du paiement numérique est largement éclipsé par la menace de la transparence fiscale.
En rendant leurs transactions entièrement traçables chaque dépôt, chaque vente, et chaque transfert étant enregistré, les commerçants craignent que l’outil de modernisation devienne, ironiquement, l’instrument de leur formalisation forcée. Cette traçabilité est perçue comme un appel direct aux services de la Direction Générale des Impôts (DGI), risquant d’ouvrir la porte à une multiplicité des taxes et redevances (Impôt sur le Chiffre d’Affaires, Impôt Professionnel sur les Bénéfices, taxe d’exploitation, taxes de l’environnement, etc.).
Pour des acteurs aux marges déjà fragiles, basculer vers un régime fiscal formel, souvent jugé lourd et complexe, signifierait une érosion de leurs bénéfices, incitant ainsi une majorité à s’accrocher farouchement aux transactions en espèces pour maintenir leur invisibilité économique et préserver la survie de leur activité.
En RDC, l’adoption explosive du mobile money est freinée par une divergence réglementaire spectaculaire, transformant l’outil d’inclusion financière en facteur d’inégalité. Tandis que des nations comme le Rwanda et la Tanzanie grâce à un soutien étatique clair et une régulation active des tarifs imposent une interopérabilité totale et garantissent la gratuité des paiements marchands, facilitant ainsi l’accès pour tous à des coûts quasi nuls de 0% à 0,5% de frais de transfert, la République Démocratique du Congo représente l’archétype du marché non régulé.
Dans ce dernier, les opérateurs peuvent imposer des frais exorbitants allant jusqu’à 3% pour le transfert ou le retrait, et la charge des frais de paiement marchand est dissuasivement supportée par le client. Cette fragmentation, exacerbée par une interopérabilité limitée, crée de fait un marché captif où le citoyen congolais paye jusqu’à six fois plus cher pour le même service qu’un Rwandais ou un Kényan, révélant que le véritable coût de la transaction mobile est moins technique qu’institutionnel et réglementaire.
La Banque centrale du Congo (BCC) a publié des directives sur la monnaie électronique notamment les Instructions 24 qui en légifère les activités des opérateurs du mobile money et 42 qui encadre les transactions liées aux cartes bancaires et aux guichets automatiques, mais sur le terrain, leur application reste incomplète. L’interopérabilité qui est le transfert d’argent entre différents réseaux de télécommunication reste partielle. Un utilisateur Airtel Money ne peut pas toujours payer un commerçant Orange Money sans passer par un transfert payant.
« Ceci est dû à la concurrence entre opérateur de télécoms car chaque réseau veut garder ses clients dans un écosystème fermé y a aussi le problème des plateformes différentes car il n’y a pas de système national d’intégration inter opérateur, une régulation insuffisante de la part de la banque centrale du Congo qui n’impose pas cette interopérabilité, mais aussi l’absence d’un switch national de payement qui est le système central de compensation électronique. Cette fragmentation empêche la fluidité du système et alimente la préférence du cash. » Nous dit Christiane Tshimpamba (nom d’emprunt) fonctionnaire (qui a voulu garder anonyme son titre au sein de la société pour sécuriser son travail) au sein du bureau Vodacom agence de Goma
Face à l’inefficacité des directives actuelles et à la fragmentation des réseaux qui nourrit l’économie du cash, la BCC active sa réponse ultime qui est l’imposition du Switch National de paiement, une réforme structurelle qui promet de transformer le paysage financier en subventionnant l’équipement des marchands et en unifiant la compensation électronique nationale nous confie Monsieur Mbambi DI-Vuavu, administrateur de bugdet a la banque centrale du Congo Kinshasa-Gombe
« La BCC est pleinement consciente des défis liés à l’interopérabilité et aux tarifs non régulés dans les systèmes de paiement mobile. Pour y répondre, la feuille de route technique et budgétaire du Switch National de Paiement prévoit Élaboration des normes d’interopérabilité, agrément des opérateurs et définition d’un tarif plafond uniforme avec une commission de moins d’1%, l’installation de la plateforme centrale de compensation électronique, intégration des opérateurs majeurs (banques, fintechs, TelCom), l’usage du SNP qui est le switch national de payement sera obligatoire pour les paiements marchands numériques et les terminaux POS/QR code, avec subventions à l’installation pour les petites structures et Les tarifs de retrait/paiement seront plafonnés et ajustés pour éviter les coûts dissuasifs, conformément à notre stratégie d’inclusion financière. »
Entre méfiance et habitudes culturelles
Le cash reste un symbole de sécurité dans une économie marquée par l’instabilité du franc congolais et la prédominance de l’informel. En début du mois d’octobre, le taux du dollar a tellement chuté, quittant de 3200fc a 2200fc pour 1 dollar Américain, une différence de 1000FC qui avait jadis la valeur de 0,3$ . Dès lors, chaque commerçant fixe le taux de change à sa guise et exige le payement en cash.
Pour une population qui, dans les zones occupées par les rebelles et qui reçois son payement via le virement par mobile money, la résistance au paiement mobile coûte très chère.
« Pour les boutiques qui acceptent le payement par mobile money, ils nous exigent le payement en dollars et nous demandent toujours d’ajouter les frais de retrait qui varient selon le cout d’achat, sans oublier aussi le pourcentage de la maison de télécom. Je suis donc appelé à être facturé doublement juste pour un achat avec mobile money d’où ma préférence du cash », nous confie Me Jean-Marie Bukondo, avocat inscrit au barreau du Nord-Kivu
« Je reçois toujours mes honoraires par transfert M-pesa, je suis obligée d’aller faire le retrait auprès d’un agent, qui a son tour me donne ses tarifs fixés par la maison de télécom : 1dollar équivaut à 2100Fc, alors que sur le marché, les commerçants nous vendent au prix de 2500Fc pour 1$. Si au moins l’utilisation mobile money était effectif sur tous les marchés, cela nous éviterait des pertes et nous faciliterai la vie dans cette région qui vient de faire presque une année sans banques » nous dit Me Melissa CIZA avocate a la clinique juridique Dynamique des femmes juristes.
Le mobile money dépend d’un réseau d’agents pour les dépôts et retraits. Mais dans plusieurs zones rurales ou dans la zone sous occupation de l’AFC-M23, les agents manquent de l’argent liquide. Cette pénurie pousse les utilisateurs commerçants à préférer le cash, plus immédiat et tangible nous dit Mr Cubaka David, tenancier d’une boutique des vivres à Bukavu.
« C’est vrai que vous voyez l’affiche qui affirme que nous acceptons le payement mobile money, mais je ne peux pas vous l’accorder ni à mes autres clients car lors des retraits, presque tous les agents mobiles money me disent qu’ils n’ont pas la somme d’argent que je cherche. Cela peut me prendre plusieurs jours pour avoir l’argent alors que je dois ravitailler ma boutique quotidiennement. »
La dépréciation du FC est effectivement un frein à l’adoption des paiements digitaux. En complément des instruments macroéconomiques classiques. La BCC étudie la mise en œuvre des comptes en dollars électroniques réglementés pour petits montants, en partenariat avec les banques et opérateurs pour garantir la valeur des fonds des utilisateurs tout en respectant la réglementation sur les devises, renforce les mécanismes de sécurité et de remboursement par l’instauration d’un délai Maximum Garanti (DMG) de 72h pour les litiges sur mobile money, la mise en place d’un Centre National de Médiation Financière Numérique avec traçabilité des plaintes et le déploiement d’un code unique de réclamation client utilisable sur toutes les plateformes, répond Monsieur Mbambi Di-Vuavu aux préoccupations des utilisateurs des terminaux de payement électroniques
Leçon du Kenya et du Rwanda
L’adoption du mobile money en RDC en 2024 est massivement concentrée sur les usages de base. 78% des utilisateurs effectuent des transferts d’argent et 72% des retraits en espèces. Ces chiffres indiquent la proportion des abonnés ayant utilisé ces fonctions, confirmant le rôle du service comme un outil de facilitation de la logistique financière et de l’inclusion, et non comme un moyen de paiement de consommation. Seuls 18% s’en servent pour payer des factures et 7% pour des paiements marchands, soulignant une persistance de la dépendance au cash et un faible impact sur la digitalisation de l’économie formelle.
Depuis 2007, selon l’étude de Georgetown University M-Pesa a transformé l’économie kényane. Plus de 90 % des adultes utilisent le service pour payer, transférer ou recevoir un salaire. Ses clés du succès sont les frais faibles, interopérabilité totale, intégration bancaire, et confiance institutionnelle
Au Rwanda, l’État pilote la transition digitale. Les paiements publics se font par mobile et les transferts entre opérateurs sont gratuits pour les petits montants. Plus de 80 % des Rwandais utilisent quotidiennement un portefeuille électronique selon le rapport FinScope 2024
Vers une RDC moins dépendante du cash
Quelques villes montrent des signes positifs. Les supermarchés de Goma acceptent Orange, M-Pesa et Airtel Money, les hôtels et stations-service de Kinshasa testent les QR codes, Mais dans la majorité des provinces (Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani), le cash reste dominant.
« Pour que cette racine croisse, la banque centrale doit, imposer l’interopérabilité, mettre en place un switch national de payement, subventionner ou inciter l’usage des terminaux de paiement POS, QR code dans les commerces et instaurer la politique incitative ‘’ zéro cash’’ dans certains payements comme le salaire, les taxes et les aides sociales. Nous devons comprendre que le succès du M-pesa du Kenya repose sur la densité du réseau d’agents, la facilite d’usage, une forte inclusion financière et une règlementation proactive. » Nous confie Monsieur Alimasi Namegabe chef d’agence de la Trust Merchand Bank TMB à Lubumbashi et expert économique
Le mobile money représente un atout numérique majeur, s’inscrivant comme une véritable Infrastructure Publique Digitale (IPD) pour le développement. Ses bénéfices sont clairs : de l’inclusion financière des populations éloignées des banques à une transparence accrue des transactions, il est un puissant vecteur de modernisation économique. Cet impact est déjà visible chez les voisins de la RDC, comme au Kenya, au Rwanda ou en Tanzanie, où la monnaie mobile est devenue un pilier du quotidien.
Toutefois, l’adoption de toute IPD n’est jamais un processus automatique. En République Démocratique du Congo, si le pays possède la ressource fondamentale d’une population jeune, connectée et intrinsèquement innovante, le potentiel du mobile money est aujourd’hui bridé. Il reste cantonné aux transferts et échoue encore à s’imposer comme un moyen de consommation généralisé.
Les obstacles sont multiples et structurels : ils témoignent de la fragilité du système financier national, pour laquelle le recours au cash sert de révélateur. Au-delà de cette défiance, il y a l’absence d’une régulation suffisamment forte et, surtout, un déficit dans l’application des règles existantes. Ces failles réglementaires, couplées à un environnement sécuritaire parfois volatil, limitent l’expansion et la confiance nécessaire à un usage de masse.
Pour concrétiser les promesses d’inclusion et de modernité, le gouvernement congolais doit capitaliser sur sa jeunesse et son potentiel d’innovation en leur apportant un soutien institutionnel. Seule une stratégie nationale claire, doublée d’une régulation rigoureuse et effectivement appliquée, permettra à la RDC de rattraper son retard et de faire du mobile money un véritable moteur pour le bien public.
Le pays a les atouts une population jeune, connectée et innovante. Son appui aux initiatives d’innovation de celle-ci pourra l’aider à pallier à cette situation. Le cash n’est pas qu’une habitude il révèle la fragilité du système financier congolais, la monnaie électronique séduit pour les transferts, mais échoue encore comme moyen de consommation. Avec une régulation forte et une stratégie nationale claire, la RDC peut rattraper ses voisins et faire du mobile money un levier d’inclusion, de transparence et de modernité.