Ils sont nés ou conçus dans la forêt, dans des cachettes de fortune, dans des camps de milices ou sur des chemins de fuite. Ils sont nés du silence, de la douleur, des viols utilisés comme armes de guerre. Et aujourd’hui, dans l’Est de la République démocratique du Congo, ils grandissent dans l’indifférence, rejetés par leurs familles, ignorés par l’État, piégés dans un destin qui n’est pas le leur.
Ces enfants, devenus parfois adultes, forment une « génération sacrifiée » dont personne ne veut répondre, une plaie béante des trente années de conflits qui ravagent le pays.
L’alerte vient cette fois d’Epimack Kwokwo, coordonnateur des programmes de la Ligue des Droits de la Personne dans la région des Grands Lacs (LDGL). A La Prunelle RDC, il dresse un tableau glaçant :
« Depuis 1996, la RDC a connu des vagues de viols, meurtres, pillages, enlèvements. Des femmes ont été emportées dans des forêts et violées pendant des mois. Elles sont revenues avec des enfants, ou parfois jamais revenues », rappelle-t-il.
Selon lui, les survivantes et leurs enfants vivent dans une complexité sociale extrême, oscillant entre rejet, précarité et traumatisme. Dans les territoires de Walungu, Kaniola, Budodo, Nyamarhege, Nzibira ou Kalehe, des centaines d’enfants issus de viols, majoritairement commis par des militaires, des groupes armés locaux et des combattants FDLR tentent encore aujourd’hui de survivre dans une société qui les regarde comme les « enfants de l’ennemi ».
Un rejet qui commence dès le retour de leurs mères
Épimack Kwokwo raconte ce moment critique où, parfois après une année ou plus d’enlèvement, les femmes reviennent dans leurs villages.
« Quand une femme revient enceinte ou avec un enfant, sa belle-famille demande : À qui appartient cette grossesse ? À qui appartient l’enfant ? C’est là que commencent le rejet et l’exclusion. »
Souvent abandonnées à leur retour, certaines survivantes sont contraintes de laisser leurs enfants chez des proches, d’autres sombrent psychologiquement, incapables d’aimer l’enfant né de leur douleur.

Dans le territoire de Walungu, la LDGL recense plus de 300 enfants nés des viols de guerre, sans soutien de leur famille ni du gouvernement. Une situation confirmée par Médecins sans Frontières, qui évoque la continuité de ces pratiques au fil des conflits.
Louise et Maombi : deux vies, une même tragédie silencieuse
Dans cette réalité brutale, deux jeunes femmes rencontrées dans la région de Ngweshe portent des histoires qui résument l’ampleur du drame. Leurs noms ont été changés pour les protéger.
Louise, 25 ans : “Je suis née d’un viol, et je paie encore le prix de cette guerre”
Sa mère, originaire de Ngweshe, faisait partie des femmes emportées dans la forêt par les FDLR, violée durant des semaines. Revenue enceinte, elle n’a jamais pu supporter la fillette née de ces violences.
« Jusqu’à sa mort, elle n’a jamais ressenti de l’amour pour moi », confie Louise d’une voix calme, mais lourde.
Rejetée, elle est envoyée chez sa grand-mère, une femme âgée et pauvre. Très jeune, Louise doit travailler comme employée de maison à Bukavu pour survivre. Elle n’a jamais connu son père. Sa mère ne pouvait y arriver également ayant été violée par plusieurs.
« Manger ou trouver du savon était un miracle. On me pointe du doigt dans la communauté : je suis “l’enfant du violeur”. Ma mère aussi portait ce traumatisme. J’aurais voulu avoir les mêmes chances que les autres enfants. »
Son récit traduit toute la violence sociale que subit cette catégorie d’enfants : une stigmatisation qui les suit partout, même dans l’âge adulte.
Maombi, 26 ans : “Je suis le souvenir vivant de ce qu’elle a subi”
Comme Louise, Maombi est née des viols collectifs commis par les FDLR. Sa mère, enlevée pendant plusieurs mois, ne sait pas qui est le père de son enfant ; plusieurs hommes l’ont violée.
« Ma mère dit qu’elle regrette de m’avoir mise au monde », avoue Maombi, sans rancœur, mais avec un chagrin profond.
Elle n’a jamais eu la chance d’aller à l’école. À chaque crise entre elles, sa mère lui rappelle qu’elle est “le fruit de ses souffrances”. La communauté le sait, le répète, le murmure.
Un jour, Maombi a failli se marier. Son fiancé était déterminé. Mais sa famille a refusé catégoriquement : « On ne peut pas prendre une fille née du viol dans notre lignée », lui ont-ils dit. Le jeune homme l’a finalement abandonnée, alors même qu’elle était enceinte.
Aujourd’hui, Maombi élève seule un enfant, elle aussi dans la précarité la plus totale.
Une bombe sociale ignorée par l’État
Selon Epimack Kwokwo, beaucoup de ces enfants ont aujourd’hui 18, 20 ou 25 ans. Certains n’ont jamais été scolarisés, d’autres n’ont reçu que l’accompagnement minimal de petites ONG.
« L’État congolais les a abandonnés. On se demande même s’il sait qu’ils existent », insiste-t-il.
Il alerte sur les dangers auxquels ces jeunes sont exposés : agressivité ou révolte liées à leur traumatisme et au rejet ; risques élevés de recrutement par des groupes armés ; reproduction cyclique de la violence.
Pour lui, une partie de la solution passe par le Fonds national de réparation (FONAREV), qui devrait intégrer ces jeunes dans ses mécanismes de réparation, notamment via : la formation professionnelle, l’intégration socio-économique, l’accompagnement psychosocial, la reconnaissance officielle de leur statut. Mais, regrette-t-il, « l’État n’a jamais mis une pensée particulière à ces enfants. »
Une tragédie dénoncée depuis des années
Ce cri survient après de nombreux autres, dont celui du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Il parle depuis des années d’une « tragédie silencieuse », dénonçant les viols comme armes de guerre et l’abandon total de ces enfants « héritiers des conflits ».
Louise et Maombi ne sont que deux visages parmi des milliers. Deux vies qui rappellent que la guerre ne s’arrête pas aux cessez-le-feu. Elle continue de vivre dans les corps, dans les esprits, dans les enfants qui grandissent avec un passé qu’ils n’ont jamais choisi. Une génération entière demande justice.
Séraphin Mapenzi
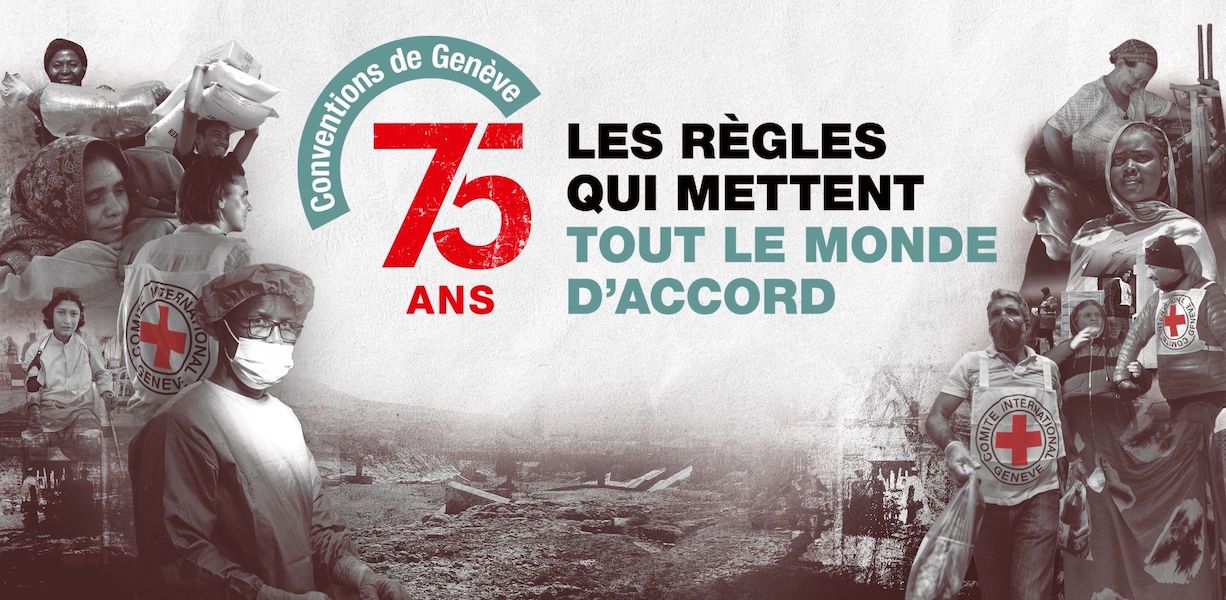

4 commentaires
Pingback: Panzi : une jeune femme tuée lors d’une attaque à main armée - La Prunelle RDC
Pingback: Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes : Me William Wilondja appelle à une sensibilisation renforcée - La Prunelle RDC
Pingback: Une femme victime de violences sexuelles toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes dans l’Est de la RDC : les « Elders » appellent à mettre fin aux conflits - La Prunelle RDC
Pingback: 16 jours d’activisme : la COMEL-RDC appelle à sécuriser l’espace numérique face à la montée des violences en ligne - La Prunelle RDC