Félix Tshisekedi s’avance-t-il vers la République ou vers le royaume du Congo ? À Kinshasa, la question n’est plus une provocation. Elle traverse les conversations politiques, secoue les chancelleries et hante jusqu’aux derniers défenseurs du régime. Car, à mesure que s’accumulent les décisions autoritaires, un sentiment de déjà-vu s’installe : celui d’un pays qui renoue avec ses vieux démons — la personnalisation du pouvoir, le culte du chef, la peur comme instrument politique.
Un pouvoir qui ne supporte plus la contradiction
En moins d’un mois, douze partis de l’opposition ont été suspendus sur toute l’étendue du territoire national. Parmi eux, des poids lourds : le PPRD de Joseph Kabila, le LGD de Matata Ponyo, la Piste pour l’Émergence de Seth Kikuni, ou encore l’ATD de José Makila. Officiellement, il s’agissait, selon le ministre de l’Intérieur Jacquemain Shabani, de préserver « l’unité nationale et la sécurité du territoire ». En réalité, beaucoup y voient un message limpide : toute voix dissidente sera étouffée.
Lire aussi : RDC : le Gouvernement suspend les activités des partis politiques PE, LGD et AAP
Des organisations de la société civile, comme la Nouvelle Société Civile Congolaise, s’en sont émues. « On ne peut pas défendre la démocratie en la bâillonnant », commente un observateur de Bukavu. Les activistes, eux, parlent d’une dérive. Jean-Claude Katende, figure emblématique des droits humains, évoque « une atteinte grave à la démocratie ».
Ce n’est pas une première. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Félix Tshisekedi a progressivement consolidé tous les leviers de commandement autour de sa personne : justice, armée, CENI, gouvernements provinciaux, médias publics… Et aujourd’hui, l’étau se resserre sur les partis politiques.
Le syndrome du “Roi Soleil”
Les mots du FCC, l’ancien front kabiliste, sonnent comme une alerte : « On bâillonne, on suspend, on réprime tout ce qui n’applaudit pas le Roi Soleil ». Une formule qui frappe juste. Tshisekedi, élu au terme d’un compromis politique en 2018, semble vouloir effacer toute trace de ce compromis et régner seul sur les ruines de l’opposition.
Son projet de révision constitutionnelle — qu’il justifie par le besoin d’« adapter » la loi fondamentale aux « réalités du pays » — inquiète plus d’un. Car derrière les mots, nombreux sont ceux qui voient un calcul clair : rendre possible une présidence à vie.
Lors d’un discours à Kisangani, le chef de l’État avait affirmé que la Constitution actuelle aurait été « écrite par des étrangers ». Une phrase que le FCC n’a pas laissée passer : « Mensonge historique », rétorquait la coalition, rappelant que le texte de 2006 est le fruit d’un large consensus issu du Dialogue intercongolais de Sun City. Et ironie de l’histoire, Étienne Tshisekedi, père de l’actuel Président, avait lui-même validé ce pacte républicain.
De la démocratie à la monarchie républicaine
Ce qui se joue aujourd’hui en RDC dépasse une querelle entre camps politiques. C’est l’esprit de Sun City — celui du compromis, du pluralisme et du partage — qui vacille. Ce pacte, né après les guerres du Congo, avait permis de restaurer une architecture démocratique fragile, certes, mais fondée sur un principe clair : plus jamais un seul homme ne décidera pour tout un peuple.
Or, la dérive actuelle ressemble à une réédition des années noires : des opposants emprisonnés ou réduits au silence ; des services de sécurité purgés et soumis à la présidence, des médias indépendants menacés ; et désormais, des partis politiques suspendus par simple arrêté ministériel.
Le tout, dans un climat où la justice apparaît de plus en plus instrumentalisée. Même au sein du camp présidentiel, certains confient en privé leur malaise face à cette fuite en avant.
Un pouvoir en guerre contre les symboles
Ce qui frappe, c’est la volonté du régime de détruire les symboles de la pluralité. En s’en prenant au PPRD, au FCC, à la plateforme Sauvons la RDC ou à des figures comme Seth Kikuni ou Franck Diongo, Tshisekedi cherche à réécrire la scène politique à son image. Une scène sans opposition, sans contre-pouvoir, sans critique.
Mais l’histoire congolaise enseigne une constante : le pouvoir absolu finit toujours par se heurter à la résistance du peuple. Le Congo n’a jamais été un royaume soumis. Il a renversé des colons, défié des dictateurs, survécu à des guerres. Croire qu’on peut réduire 100 millions de Congolais au silence, c’est oublier la force tranquille de ce peuple.
Lire aussi : Le projet de changement de la Constitution est une déclaration de guerre (FCC)
La décision de suspendre les partis issus du conclave de Nairobi en est la parfaite illustration, même si, justement rien ne plaide en faveur de ces opposants visiblement soutenus et soutenant le Rwanda et les rebelles du M23. Cette décision est-elle née, d’une menace réelle, ou d’une peur : celle d’une opposition qui commence à s’organiser, qui ose se parler, qui se projette au-delà de la ligne rouge tracée par le pouvoir ?
« Cette décision prise sous le coup de l’émotion démontre les limites du gouvernement », a dénoncé Seth Kikuni. Et il a raison. Ce n’est pas la force d’un régime sûr de lui, mais la fébrilité d’un pouvoir qui redoute sa propre ombre.
Un pays à la croisée des chemins
La RDC n’a pas besoin d’un roi. Elle a besoin d’un Président lucide, capable de rassembler au lieu d’éliminer. D’un chef d’État qui respecte les institutions, au lieu de les absorber. D’un dirigeant qui comprenne que la grandeur d’un mandat ne réside pas dans la durée du règne, mais dans la solidité de la démocratie qu’il laisse derrière lui.
Si Félix Tshisekedi persiste dans cette voie, il risque de devenir ce qu’il a toujours prétendu combattre : un autocrate.
Et l’histoire, impitoyable, retiendra qu’il a hérité d’une République… pour en faire un royaume.
Jean-Luc M
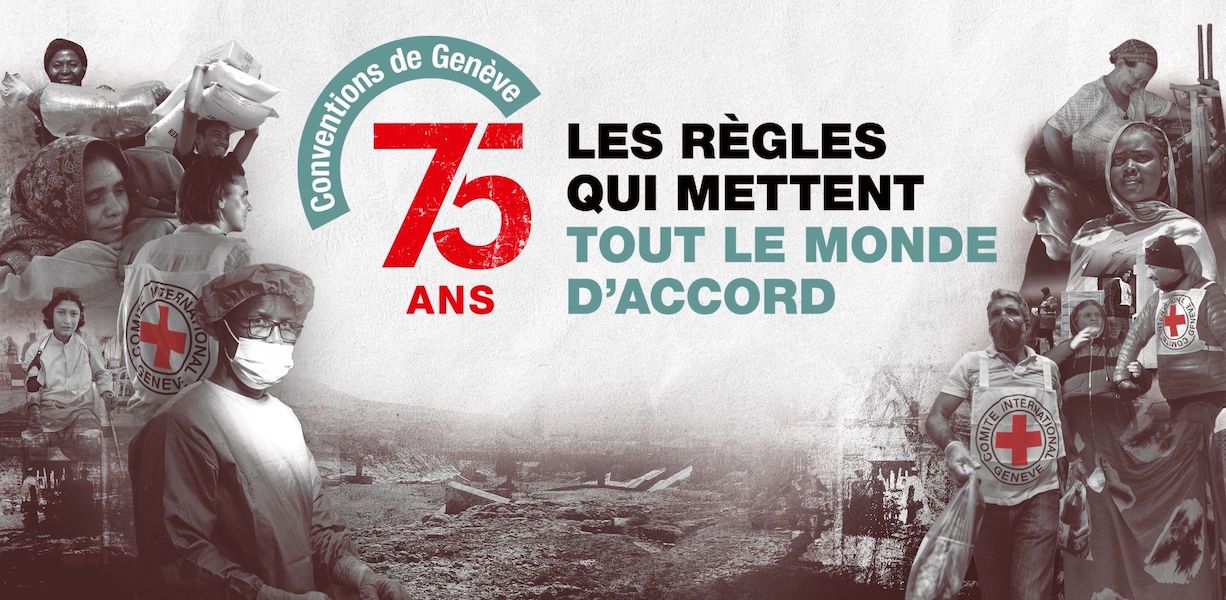

4 commentaires
Pingback: RDC : le Président Tshisekedi attendu ce lundi 8 décembre devant le Parlement réuni en Congrès - La Prunelle RDC
Pingback: Coupe du Monde 2026 : Les Léopards à 90 minutes de l’éternité, Tshisekedi galvanise toute la Nation - La Prunelle RDC
Pingback: Fin de l’attente : la nouvelle carte d’identité congolaise arrive d’ici 2026 - La Prunelle RDC
Pingback: Discours de Félix Tshisekedi : Entre espoir et critique, l’opinion reste divisée à Bukavu - La Prunelle RDC